Antibiorésistance : les bactériophages, une nouvelle arme ?
Nos articles signatures • 04/11/2025 • 5 min
Face à l’explosion de l’antibiorésistance, les chercheurs doivent faire preuve d’inventivité. Lorsque les médicaments ne suffisent plus, pourquoi ne pas se tourner vers les ennemis naturels des bactéries, les bactériophages ?
Ces petits virus, capables d’infecter les bactéries, sont une nouvelle piste pour les éradiquer. Xavier Bellanger, expert Unys, enseignant-chercheur en microbiologie au LCPME (CNRS – Université de Lorraine) et les équipes du LCPME se sont penchés sur la question. Leur cible ? Les infections liées aux opérations et poses de prothèses, véritable terrain de jeu des bactéries où elles prolifèrent aux zones de contact. L’idée, c’était de penser une nouvelle approche thérapeutique, là où les antibactériens ne sont plus aussi efficaces
, explique le chercheur. Naturellement présents dans l’environnement, les bactériophages, ou tout simplement phages, régulent les populations microbiennes. Ils peuvent même, dans certains cas, les rendre plus résistantes et plus virulentes. Mais ici, c’est leur pouvoir destructeur que l’on cherche à mettre au service de la science et de la médecine.
- Santé
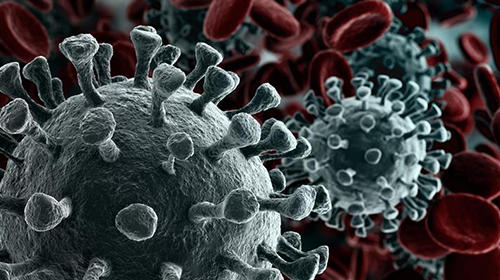
Antibiorésistance, un fléau mondial
L’antibiorésistance est aujourd’hui responsable d’environ 1 million de morts par an dans le monde. À ce rythme, certains estiment qu’elle deviendra l’une des premières causes de mortalité d’ici 2050, avec près de 2 millions de morts par an. C’est un véritable problème de santé publique. Dans les hôpitaux, les infections nosocomiales inquiètent particulièrement, causées par des bactéries opportunistes. Elles profitent d’une plaie ou d’une opération pour s’infiltrer, proliférer et causer de graves dommages. Parmi elles, le chercheur a décidé de cibler le staphylocoque doré, courant sur la peau ou les muqueuses.
Certains virus pourraient devenir des alliés contre les bactéries. C’est tout l’enjeu de la phagothérapie. Cette approche a déjà été testée sur des animaux dans le cadre vétérinaire et des patients humains au cours d’usages très ponctuels. Utilisée pour les premières fois dans les années 1920, elle a été mise de côté dans les pays occidentaux avec l’avènement des antibiotiques. Mais face à l’impasse actuelle, elle refait surface dans les laboratoires du monde entier. L’un des défis à relever avant un usage à grande échelle de la phagothérapie reste de trouver les bonnes modalités d’administration de ces virus. Dans ce contexte, est né PHAGERIALS, dédié à l’optimisation des modalités d’administration des bactériophages. Ce projet va nécessiter un véritable travail interdisciplinaire entre équipes de microbiologie, physico-chimie des biomatériaux, bio-informatique…
, rapporte Xavier Bellanger.
Un virus dans un pansement, vraiment ?
Pour concevoir cette solution applicable, l’équipe a d’abord identifié les phages efficaces contre un large spectre de staphylocoques et sûrs pour un usage thérapeutique. Ensuite, le choix a été fait de développer des matériaux capables de les accueillir à la manière d’une éponge moléculaire, sans altérer leur pouvoir d’infection ni leur survie. Mais surtout, il faut que ces matériaux puissent délivrer les virus sur le site de l’infection afin de trouver le bon mode d’administration. Entre pansements classiques ou en sprays, les chercheurs misent sur des technologies déjà existantes à adapter. Pour cela, ils ont imaginé des hydrogels favorisant la cicatrisation tout en limitant la prolifération des bactéries. La texture souple épouse parfaitement la zone à traiter et protège les virus qu’ils transportent.
On ne devait surtout pas travailler à l’aveugle, on a donc fait toute la caractérisation des matériaux et des micro-organismes
, explique Xavier Bellanger. L’un des défis majeurs est la compatibilité entre les virus et les matériaux utilisés d’un côté, et entre ces matériaux et les tissus vivants de l’autre. Toutes les propriétés physico-chimiques ont été passées au crible, stabilité chimique, résistance mécanique, comportement en milieu biologique, pH du gel… Les chercheurs observent aussi la diffusion des phages dans les hydrogels, leur stabilité dedans, ou encore leur libération progressive au contact de tissus biologiques.
Un cocktail de phages pour plus d’efficacité
Les phages n’ont pas tous les mêmes cibles ni les mêmes propriétés. Pour optimiser l’efficacité, nous travaillons à la formulation de cocktails de phages dans un seul et même gel
, développe Xavier Bellanger. L’objectif ? S’assurer qu’ensemble, ils puissent attaquer efficacement un large panel de souches de staphylocoques. L’équipe de recherche a déjà renforcé la structure même des hydrogels grâce au maillage des fibres qui améliore sa stabilité et le maintien des virus dans le temps. Les matériaux utilisés, comme l’acide hyaluronique ou le poly (hydrochlorure d’allylamine), sont choisis pour leur biocompatibilité et leur potentiel antibactérien.
Mais le projet ne s’arrête pas là. On ne doit pas oublier la génomique dans cette histoire !
, prévient le chercheur. Il faut s’assurer que les phages ne transportent pas eux-mêmes des gènes de résistance ou de virulence qu’ils pourraient transférer aux bactéries. Le problème serait aggravé plutôt que résolu. Des analyses génétiques approfondies sont menées pour séquencer les phages. Ce travail de criblage est indispensable avant toute application clinique sûre.
Un tremplin vétérinaire vers la médecine humaine
Dans un premier temps, ce nouveau traitement est destiné à un usage vétérinaire, chez les animaux de compagnie. Les réglementations sont plus souples que pour un usage humain. Une fois l’efficacité prouvée, le traitement pourrait être élargi à la médecine humaine, en tant que nouvelle thérapie. Mais cette solution n’est pas universelle. Chaque infection, chaque bactérie, chaque patient, peuvent nécessiter un traitement spécifique. Le déploiement est complexe et coûteux. Puis, il y a la question de l’accessibilité. La demande de patients atteints d’infection pour lesquels les antibiotiques n’ont plus d’effet est fréquente mais nous devons encore travailler au niveau national et européen avant de pouvoir proposer à tous ces traitements
ajoute Xavier Bellanger. Des travaux avec des collègues en Sciences Humaines sont également en cours pour accompagner le développement de la phagothérapie, trouver les bons mots et les bons formats pour sensibiliser le public à cette approche innovante.
Les bactéries vont-elles résister au remède ?
De nombreuses étapes restent à franchir. Il faut mesurer le pouvoir bactéricide des phages stockés dans l’hydrogel, ainsi que la capacité d’échappement à cet effet des bactéries. Et comme elles peuvent vivre en communauté, appelée biofilm, il est nécessaire de vérifier que les phages ont également une activité bactéricide dessus. Il faut aussi garantir que les matériaux restent intègres dans le temps et développer des variantes pour s’adapter aux différents profils de bactéries, de pathologies et de potentiels patients (allergies, sensibilité thermique, etc.). Et la dernière priorité, s’assurer que ces traitements n’induisent pas de réponse immunitaire indésirable. Si ces verrous sont levés, la médecine de demain pourrait bien miser sur les virus.
Sources
Cenraud, É. et al. Biophysical Characterization of Phages for Integration into Antimicrobial polymer matrices: Towards Prophylactic Applications Against.
Cenraud, E. et al. Developing the next generation of anti-staphylococci bacteriophage-based biomaterials.
Développement de la prochaine génération de biomatériaux anti-staphylocoques à base de bactériophages. Agence nationale de la recherche https://anr.fr/Projet-ANR-22-CE19-0024.
Ekrami, S. et al. Exploring the Mechanical and Chemical Properties of Cross-Linked Poly(allylamine)-hyaluronic Acid Multilayer Films Using a Chemometric Unmixing Approach. ACS Appl. Polym. Mater. 5, 8533–8546 (2023).
Francius, G. et al. Impacts of Mechanical Stiffness of Bacteriophage-Loaded Hydrogels on Their Antibacterial Activity. ACS Appl. Bio Mater. 4, 2614–2627 (2021).
Benech, N. et al. Les virus au service de la santé : les bactériophages. Med Sci (Paris) 38, 1043–1051 (2022).
- Bactérie
- Virus
