Utiliser la lumière pour comprendre la matière
Nos vidéos capsules • 10/07/2025 • -2 min
David Chapron, maître de conférences à l’Université de Lorraine et directeur du LMOPS, explique comment la spectroscopie laser permet d’analyser les matériaux à distance, avec une extrême précision.
Une technique au cœur de nombreuses collaborations scientifiques, de l’analyse de procédés de fabrication à la mise au point de capsules intelligentes pour le traitement de certains cancers.
- Ressources et Environnement
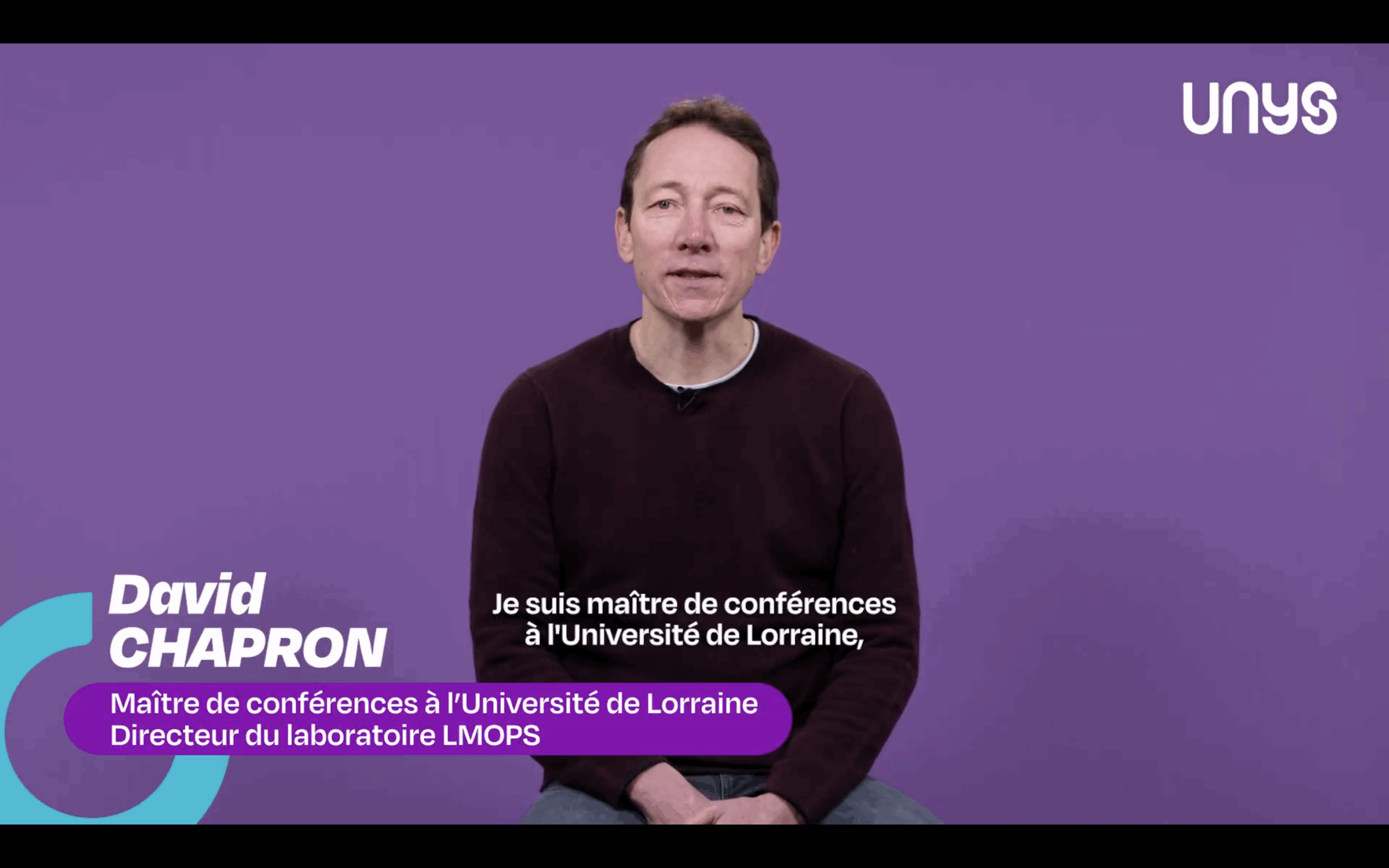
-
Transcription textuelle
Je suis maître de conférences à l’Université de Lorraine, donc enseignant-chercheur.
Je suis également Directeur du laboratoire LMOPS
Mon rôle au sein du laboratoire, c’est d’effectuer des recherches dans mes spécialités qui sont l’optique, les matériaux.
Mes thématiques sont assez variées dans le sens où je collabore assez régulièrement avec d’autres collègues qui ont des thématiques propres où ma technique de spectroscopie les intéresse particulièrement pour analyser leurs matériaux ou leurs procédés de fabrication.
La technique de spectroscopie est redevenue à la mode, si on peut dire,
La technique de spectroscopie est redevenue à la mode, si on peut dire, parce qu’on peut analyser des choses qui sont beaucoup plus précises qu’avant et de façon beaucoup plus efficace.
On envoie un faisceau laser, donc une lumière sur un matériau.
Donc l’intérêt, c’est de pouvoir faire une mesure à distance, à quelques millimètres ou éventuellement à quelques mètres.
On récupère une partie de cette lumière que l’on a envoyée, et cette lumière-là, on va l’analyser, ça va nous donner des informations sur le matériau, c’est-à-dire de quoi il est composé.
Je travaille notamment sur l’analyse de petites capsules qui sont destinées au traitement de certains cancers pour qu’elles diffusent les substances médicamenteuses au bon moment et pendant la bonne durée.
Mon rôle à moi, c’est d’essayer de comprendre comment les processus de diffusion se font.
C’est-à-dire que nos capsules mêlent une substance médicamenteuse très classique et on regarde la vitesse avec laquelle cette substance est relarguée au sein d’un milieu qui peut ressembler à un milieu biologique.
Dès qu’on contrôle un petit peu ce processus de diffusion, à ce moment-là, on va pouvoir commencer à voir comment ça a un impact sur des tissus, comment est-ce que ce processus de diffusion s’effectue correctement dans un milieu tissulaire, si ça fonctionne, avant de passer à une étape clinique.
